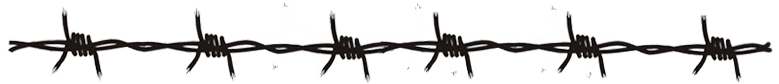Il est de ces territoires où l’obscurité nous enveloppe entièrement dans la nuit noire. Au loin, les cris des aînés qui chantent en innu-aimun près de la cabane de pêche où se sont côtoyés, à travers les générations, âmes défuntes et jeux d’enfant.
Face aux vagues caressant le rivage, le visage froid, deux halos de lumière viennent éclairer nos kamiks en peau de phoque enfouies dans le sable.
Uapikun (“Fleur”) et Shipiss (“Petite rivière”) se dirigent vers nous, emmitouflées dans leurs manteaux assorties à leurs mèches. Uapikun est vêtue de rose. Shipiss, elle, de bleu. Armées d’une lampe frontale et de seaux, elles guettent le mouvement frénétique des frêles poissons rejetés par les vagues noires. | Article et illustrations par Momo Tus
Inspiré du roman “Kuessipan” de Naomi Fontaine & du film de Myriam Verreault
Libres dans la seule contrainte de survivre.
Dans ma langue maternelle, le mot liberté, au sens large, n’existe pas. Il faut peut-être connaître la captivité pour se figurer ce que c’est la liberté. Je cherche un mot qui pourrait s’en rapprocher. Peut-être Nutshimit.
Kuessipan, Naomi Fontaine
Au lendemain de cette pêche nocturne, nous voilà sur la route 138 qui longe le fleuve Saint-Laurent. On rentre à la “réserve” Uashat dans la baie des Sept-Îles. Ça joue à l’équilibriste pour attraper des saumons. On sourit en pensant à cette phrase: “Les Innus sont des gens de rivière”.
L’imaginaire du Nutshimit – l’intérieur des terres – nous emmène aux confins de paysages à la fois sublimes et terrifiants, marqués par l’isolement et le froid. De vastes terres passant d’un rouge flamboyant à un blanc apaisé selon les saisons. Cérémonies, chants de gorge, histoires orales, tous ces rites apportent, par ce lien avec la terre, sérénité face aux remous du monde moderne. C’est ce que les Innus appellent le “silatuniq”: le respect des éléments et des esprits qui nous entourent, mais aussi et surtout, des relations qui les lient.
On y est, dans la “réserve”. Un sentiment d’espace clos sur lui-même. Les maisons en bois se succèdent.
C’est là où habitent Shipiss, ses parents, ses quatre frères et sœurs et sa grand-mère. C’est petit, on s’y bouscule, mais il y fait bon et doux. Dans le salon, une multitude d’attrape-rêves veillent sur une dizaine de boîtes ouvertes, remplies de perles et de grigris de toutes les couleurs. Une longue bâche verte est déployée sur le sol sur laquelle repose un caribou. Le père, Tshiuetin (“Vent du nord”), dépèce la bête.
Tout comme lui, Mashkuss (« Ourson« ), le frère, a appris avec ses aînés à chasser le caribou ou encore le phoque. Arborant fièrement le maillot de son équipe de hockey, il nous rejoint sur le banc au bord du fleuve. Sous le soleil radieux, seul le vrombissement des motoneiges se fait entendre.
Pour Mashkuss, “L’attachement au territoire est ce qui nous lie encore au passé et aux aînés. Les activités de chasse, de cueillette ou de pêche nous apportent un sentiment de partage, d’appartenance et de liberté. C’est un lieu pour s’échapper et pour se soigner.”
La mobilité sur le territoire n’est pas réglementée: ils s’y sentent libres.
Son regard se porte sur la fumée s’échappant d’un grand tipi blanc dans le jardin. C’est ici que, de temps à autre, sa grand-mère, Nuna (“Pays”), née dans un campement, s’installe pour renouer avec la “vraie” vie innue.
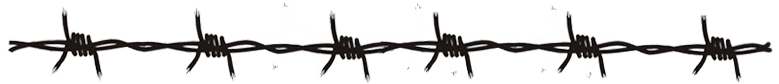
Tuer l’indien dans le cœur de l’enfant.
Nutshimit n’est pas un lieu. C’est l’immensité. La réserve est un lieu. Je déteste ce mot. Mais puisqu’il existe, il faut la nommer. Je crois qu’il est possible, sans s’en rendre compte, que le lieu qu’on habite déteigne sur soi. De croire ces personnes qui nous dictent qui l’on est, de nous restreindre à un quotidien peu ambitieux et d’accepter docilement que nous sommes nés sans envergure.
Kuessipan, Naomi Fontaine
Dans la tente de Nuna, tout est d’un blanc incroyablement serein, de ses longs cheveux blancs à l’herbe gêlée. À même le sol, près du poêle à bois, elle fume l’herbe qui se roule et non pas qui se foule, qui embrume l’air et l’esprit.

Pour beaucoup d’aînés, les nouvelles générations ne sont pas des “vrais”, du fait du fossé linguistique et culturel. Il faut dire que les aînés portent en eux une souffrance de tout un peuple qu’aucune parole ne saurait panser.
Entre deux longues bouffées de fumée, Nuna nous explique que l’ostracisation des Innus forcée par le gouvernement a entraîné une perte des droits sur leur territoire et la fin du nomadisme.
“Les chiens de traîneaux ont été abattus, réduisant ainsi notre capacité à se déplacer”. Des centaines d’enfants seront retirés et placés dans des pensionnats catholiques pour “civiliser l’autochtone”. Une dépossession de la terre, mais aussi de l’esprit. Une confiance de tout un peuple brisée en leurs aptitudes à faire société, en leurs savoirs et culture.
“Viols et tortures pour tuer l’indien dans l’enfant, et en faire un blanc.” En fait, ils ont tué l’enfant.
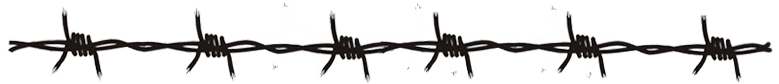
Des jeunes filles au ventre rond, des garçons partis trop tôt.
“J’ai créé un monde faux. Une réserve reconstruite où les enfants jouent dehors, où les mères font des enfants pour les aimer, où on fait survivre la langue. Mais qui veut lire des mots comme drogue, inceste, alcool, solitude, suicide, chèque en bois, viol ?”
Kuessipan, Naomi Fontaine

Les jeunes semblent en porter le poids, comme une malédiction qui se transmet. Comment se réaliser dans ces réserves qui annihilent votre existence, en vous rappelant quotidiennement ces traumatismes ?
On est rentrés au chaud à la maison. Les langues se bousculent. Avec la scolarisation et l’occidentalisation, les jeunes réservent l’inuktitut pour les aînés et le français pour le reste.
Pourtant, ils restent en marge. L’isolement et ses conséquences en termes d’accès aux services, au travail, à l’école et même à des biens de première nécessité marquent leur quotidien. Des filles au ventre rond, des garçons partis trop tôt, des maris qui titubent, des femmes aux bleus cachés, des vies volées. La liste est longue.
Au loin, des cris d’alerte. Des loups qui se sont approchés du territoire. Uapikun, dehors avec son bébé, se réfugie avec nous.
Vêtue d’un pantalon noir et d’un sweat violet, piercing au labret, les écouteurs autour du cou diffusant la voix lointaine de Beyoncé, elle traîne toujours dehors, à la recherche de la sérénité que le foyer ne peut lui apporter.
Uapikun pense qu’il n’y a pas d’avenir possible ici. « Les aînés nous critiquent, nous empêchent d’aller de l’avant et sont coincés dans le passé. Nous les jeunes, nous ne sommes plus des chasseurs. La chasse, c’est pour se ressourcer, mais plus pour subsister. On n’en peut plus d’être seulement Innu. »
Pour beaucoup, l’assimilation allochtone aura dévalorisé la culture innue auprès de toute une génération.
S’ils ne se sentent ni Innus, ni Qallunaat (Allochtones), qui sont-ils ? Rester coupé du monde mais protéger son héritage, ou partir pour prendre le train à vitesse grand V du temps présent ? Les jeunes Innus se cherchent et tanguent entre passé et présent. Ils tanguent, là, sur la déchirure du monde.
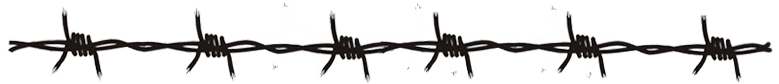
De la banquise au congélateur.
Un monde présent dicté par la culture occidentale qui s’entrechoque. À l’école, l’apprentissage s’appuie sur les habiletés en lecture et en écriture. Or, dans la culture innue, c’est la transmission orale qui accompagne l’enfant, par des rites initiatiques, vers l’âge adulte. Le calendrier scolaire est aux antipodes des activités traditionnelles, tout comme l’usage unique du français alors que les Innus construisent leur perception du monde via leur langage et chaque mot revêt une symbolique.
On pense à tout ça, réunis en ce soir de fête avec toute la famille dans la petite maison. Des loupiottes de couleurs éclairent l’entrée. Ça mange, ça danse, ça chante. On se dit que le tableau n’est pas si noir.
Il y a des aînés, des jeunes et des moins jeunes. On chante en Inuktitut sous fond de tambours en peau de caribou. Mais on boit de la bière dans des verres en plastique rouge. On mange des sushis au saumon pêché la veille. Mais on déguste aussi les gâteaux achetés à la supérette locale.
Si on regarde ce qu’ont accompli les Innus au cours des deux dernières générations, il apparaît clair que leur peuple millénaire avait déjà développé, du fait de sa capacité d’adaptation aux choses de la Terre, des pratiques et des valeurs capables de s’adapter aux défis du nouveau monde. Capable de passer de l’enfermement à la grandeur. Capable de passer du frigo rempli de bières au froid des rivières.
Les Innus ont réussi à s’approprier cette “réserve”, pour faire de cette prison une maison, unis contre l’oppression. En fait, on ne l’a jamais vraiment aimé ce mot, “réserve”. Il revêt toute une violence symbolique de l’enfermement. Il n’y aucune liberté là-dedans.
Mais, qu’en est-il du dehors ?
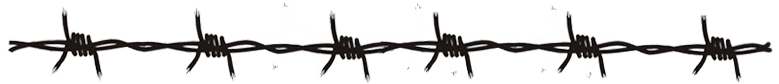
Retrouver sa fierté.
La fierté n’est pas une émotion refoulée, ni des plumes portées sur les cheveux, ni des perles cousues sur ma veste. La fierté est quelque chose qui se construit. Pour se tenir droit, il faut d’abord croire qu’on est légitime.
Kuessipan, Naomi Fontaine

En ville, il est difficile pour les Innus de trouver leur place.
Ou plutôt, on ne la leur donne pas. L’exil en milieu urbain, pour étudier ou rêver d’une autre vie peut s’avérer être un véritable choc face à l’économie capitaliste, au racisme et aux préjugés.
Quand il fait froid, il ne reste plus qu’eux dans les rues des grandes villes. Ceux qui ont fait le choix de partir, mais qui sont tombés dans l’errance.
La grande sœur de Shipiss, elle, a disparu. Comme de nombreuses femmes innues en ville, dans le plus grand silence. Pourtant, si l’isolement génère des incompréhensions entre Innus et les non-Autochtones, certains jeunes arrivent à dépasser les barrières invisibles en s’installant en ville et en portant une nouvelle perception du monde en résistance à la marginalisation.
En créant des institutions innues, des groupes de musique, des collectifs d’artistes, des entreprises en dehors de la réserve, ces jeunes donnent une visibilité au peuple, à leur culture, tout en créant des espaces publics sains.
Des espaces où la parole innue est valorisée en tant que parole citoyenne et où les traditions sont préservées.
Ainsi commencent à voir le jour les premières maisons innues d’édition et de production de films – le recours à ces deux médiums étant pourtant
contraire à la tradition orale –
mais aussi une meilleure sensibilisation de l’école à la réalité autochtone (histoire des Innus, option langue innue…) et un développement de rencontres entre Autochtones et non-Natifs.
Mais il est crucial que l’apport des Innus en ville ne soit pas uniquement considéré sous le plan culturel mais bien économique. Les Innus sont maintenant aussi des entrepreneurs, des gens d’affaires, qui contribuent au développement de la ville.
En arrivant à porter comme une fierté la richesse de leur héritage, ces jeunes montrent que les valeurs innues peuvent être à la fois préservées et comprises au sein même du monde moderne. La tradition n’est plus vue comme une éternelle répétition de l’identique, mais ouverte, fluide, comme une continuité dans le changement induit par le monde dans lequel nous devons coexister.