« Une presse libre pour l’Occitanie »
Vu de l’extérieur, L’Empaillé est une revue militante de très bonne facture basée en Aveyron.
En mars 2021, nous avons constaté que le trimestriel devenait régional (diffusé sur l’ensemble de la région Occitanie)… et qu’il était désormais tiré à plus de 20000 exemplaires ! Du jamais vu dans le sud-ouest de la France, surtout avec un contenu aussi radical, engagé et diamétralement opposé aux lignes éditoriales bien sagement rangées du côté du pouvoir (La Dépêche en tête, pour ne pas la citer). Nous pensions que c’était impossible, L’Empaillé l’a fait !
Voici le compte-rendu de notre discussion avec Simon, membre de l’équipe du journal.
| Propos recueillis par Polka B.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le journal, consulter les articles ou vous abonner :
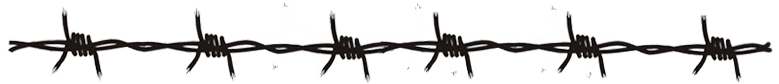
Comment présenterais-tu le journal à quelqu’un qui n’en a jamais entendu parler ?

Ça dépend à qui je parle… (Rires).
On essaye de faire un journal local engagé qui relaie les luttes sociales de tous horizons. On le voit comme un relais des luttes avec un volet « enquête critique » face à la bourgeoisie, au pouvoir politique, économique et médiatique.
On essaie aussi de ne pas se placer dans le « journalisme classique ». On aime ce côté décalé qui incite à développer des imaginaires. Cela peut passer par la poésie.
On aime aussi parler à la première personne dans les articles.
Ce sont bien souvent les personnes qui mènent directement des combats qui prennent la plume et retranscrivent leur vécu, sans intermédiaire. Écrire sur ce qui touche personnellement, c’est un parti pris qui peut compléter l’angle des enquêtes vues de l’extérieur.

Comment avez-vous eu l’idée de lancerl’Empaillé ? Pourquoi s’être étendu à l’échelon régional ?
Je viens de Lille et avec d’autres amis nous écrivions dans La Brique. Quand j’ai débarqué par ici avec d’autres, nous voulions continuer sur cette lancée. Nous avions la volonté de percer ce plafond de verre qui restreint souvent la portée des petits journaux alternatifs qui tirent à 1000 exemplaires. On voulait tenter quelque chose. On n’avait pas non plus l’ambition de concurrencer les « gros médias », juste cette envie d’aborder certains sujets en touchant davantage de personnes. À un certain moment, on a pu développer un réseau qui s’étendait au delà du département de l’Aveyron. Il y avait un côté exaltant dans l’idée de s’étendre. Petit à petit, nous en sommes arrivés à imprimer 20000 exemplaires tous les trois mois. La zone de diffusion est assez grande, et pour un journal comme le notre, je pense que c’est quelque chose de nouveau.

En lisant vos éditos, on a le sentiment que vous avez construit le journal en opposition à un certain type de presse.
Quand nous avons lancé le journal, nous avions un peu ce mot d’ordre. Celui de dire : « On va s’attaquer à La Dépêche ». C’est un peu vrai, mais ce n’est qu’une de nos facettes. On ne se focalise pas uniquement sur la presse dominante. J’ai justement l’impression qu’on se réfère davantage à la presse indépendante.
Quand on se plonge dans certaines enquêtes, on se passionne pour le sujet et on oublie rapidement cette presse invasive qui est déjà partout.
On préfère se concentrer sur ceux qui nous lisent. C’est surtout pour eux qu’on se bat. Il faut que certaines choses se sachent.
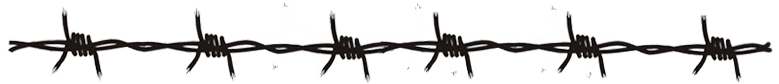
Pour une revue militante, on a trouvé votre façon d’écrire plutôt ouverte, et accessible au plus grand nombre. Était-ce un de vos objectifs ?
C’est un des enjeux les plus importants même si ce n’est pas toujours simple. D’un côté, on souhaite être rassembleurs vis à vis de la « gauche combative ». De l’autre, on veut s’adresser à tout le monde. C’est pour cela qu’il est si important d’être présents dans les kiosques et les lieux de proximité. Si l’on se cantonne à la sphère militante, on devrait fatalement tirer à moins d’exemplaires, et parler à un cercle plus restreint. C’est important que les militants s’y retrouvent, mais ce ne sont pas les personnes que nous visons en priorité au moment où on fait le journal.
Comment avez-vous réussi à trouver un modèle économique en gardant votre liberté de ton ?

Dès le départ, nous avons pu bénéficier de la subvention dédiée à la presse associative. Ce sont les miettes que le ministère de la Culture veut bien nous laisser ! Nous avons aussi créé notre fondation qui s’appuie sur pas mal de projets militants. Pour résumer, nous avons aujourd’hui deux contrats aidés et deux contrats à temps partiels. Il faut aussi financer les frais du journal (l’impression, les envois etc.). A l’arrivée, nous parvenons à payer tout cela avec les ventes à hauteur de 50 %. L’autre moitié repose sur les subventions. Cela reste précaire. L’enjeu, c’est d’augmenter les ventes pour être le plus autonomes possible.
En plus des kiosques et des abonnements, notre réseau d’auto-diffusion est très important. C’est celui que nous gérons en direct via des envois de colis. Au sein de notre équipe, une personne très motivée se charge de trouver des nouveaux lieux de diffusion dans toute la région. Aujourd’hui, nous en avons 300. Si l’on souhaite développer un modèle autonome, nous devrions en avoir 500 ou 600. L’enjeu du moment, c’est de pouvoir se passer des subventions.
C’est quoi pour toi, être un média libre ?
Écrire librement sur tous les sujets. Pour le moment, le régime politique actuel nous y autorise « à peu près ». Pour le reste, faire vivre un journal « libre » sur le long terme… voilà la vraie épreuve. À moyen terme, le fait d’avoir bénéficié de subventions ne nous a pas contraint à éviter certains sujets. Sur ce point, c’est non-négociable.
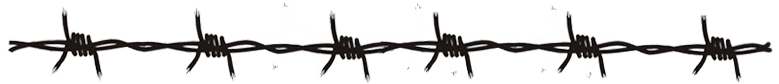
Comment le journal a t’il été accueilli par les gens ? Vous êtes très incisifs vis à vis de la presse locale dominante, mais elle reste importante pour plein de personnes, notamment les plus âgées…


C’est vrai que La Dépêche porte un rôle de relais associatif. Mais c’est aussi parce qu’il n’y a rien d’autre ! Si tu veux communiquer quelque chose, sur n’importe quel sujet ou événement à venir, c’est le seul interlocuteur possible. Face à cette situation : impossible que ce journal ne marche pas.
D’ailleurs à nos débuts, plusieurs kiosques nous ont contacté pour nous dire merci. Cela leur faisait vraiment du bien d’avoir au moins une alternative en local. Qu’au moins une publication puisse venir bousculer cette hégémonie.
Rien qu’un peu… En fait, nous n’avons jamais ressenti d’hostilité à notre égard. Même la Dépêche n’a rien dit. Leur mot d’ordre, c’est « motus et bouche cousue ». C’est l’ambiance… Les gens font leur taf et personne ne parle.
Penses-tu que vous ayez réussi à dépasser l’entre-soi militant ?
Je pense que oui par rapport à tous les lieux de diffusion avec lesquels nous travaillons. En plus de cela, nous avons eu l’occasion de donner la plume à certaines personnes qui ne viennent pas du tout de ce milieu. Au niveau du public, c’est un peu plus compliqué à estimer. On ne sait pas vraiment qui nous achète. Nous sommes sûrs d’une chose : nous servons vraiment à quelque chose. Il faut des journaux pour faire avancer des luttes.
Dans l’édito du numéro 3, vous appeliez à « résister joyeusement ». Est-ce un de vos mots d’ordre ?

Philosophiquement, cela nous intéressait de décortiquer le mot « joie ». Quand on fait notre journal, il y a une grande part d’épanouissement personnel. C’est très important. Cela nous porte. On veut se marrer, créer des choses originales, sortir des schémas classiques, trouver de nouvelles formes d’actions… On veut s’autoriser tout cela. Je l’ai vu personnellement quand j’ai fait partie de certains collectifs. Quand tu te fais chier, cela ne marche pas ! L’épanouissement passe aussi par la création. Et les projets peuvent d’autant plus aboutir. C’est ce qu’on a voulu dire je pense.
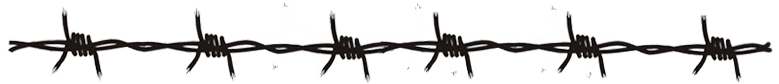
Un dernier mot ?
Le numéro 7 sort… (« Abondance, Pénurie… Rentrée Sociale! »). On est contents. On va pouvoir se poser quelques jours. Merci à vous !

