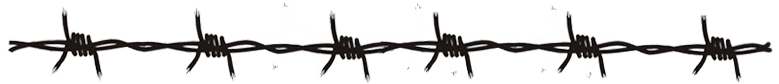Interviewer Elías Taño ? Rien de plus logique pour l’équipe de Karton : ses peintures recouvrent la plupart des murs des squats que nous visitons à travers l’Europe depuis plusieurs années ! Immédiatement reconnaissables, de Poznań à Granada en passant par Bari, les fresques imposantes du natif de Tenerife (Îles Canaries) rendent un hommage appuyé au DIY, initiatives collectives solidaires, actes antifascistes et réquisition de bâtiments abandonnés dédiés à l’accueil des réfugiés.
Aujourd’hui installé à Valence en Espagne, Elías Taño anime des ateliers, auto-édite ses ouvrages, perfectionne sa technique de sérigraphie, et surtout (pour notre plus grand plaisir) dégaine pots, échelles et pinceaux pour recouvrir des surfaces particulièrement massives en pleine rue.
Au cœur de cet univers graphique engagé (mais muet), voici l’occasion d’en savoir un peu plus sur la vision du mystérieux Elias !
| Par : Polka B.
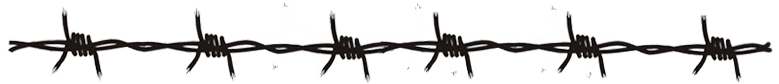

Peux-tu te présenter brièvement ? Comment as-tu commencé à peindre ?
Je suis quelqu’un qui mets tout son temps et son enthousiasme dans le dessin sur beaucoup de supports différents. La trame principale de mon travail reste le dessin politique. Une façon de dessiner qui s’inscrit dans une appartenance de classe bien spécifique et dans un sens de la mémoire antifasciste. J’ai commencé à peindre par hasard, sur la façade d’un théâtre appartenant à des amis au Chili. C’était improvisé, mais j’ai tout de suite compris la capacité mobilisatrice que peut avoir un mur quand on y expose des questions politiques.
Tu as choisi de garder ton vrai nom, tandis que les graffeurs utilisent un pseudo. L’illégalité (donc l’anonymat) n’est-elle pas conciliable avec ta peinture ?
À proprement parler, je ne suis pas vraiment lié au monde du graffiti ou du « street art ». Je suis venu au format mural comme une conséquence politique de mon travail de dessinateur.
Si vous êtes capable de réfléchir l’espace public et les contradictions du système capitaliste, que vous pouvez créer une conscience de classe, et anticiper que vous devez remettre en question les rapports de force, pourquoi ne pas le faire ?
L’anonymat n’a aucun sens pour moi dans un travail qui est politique, donc je n’ai pas besoin de cacher mon visage. Comme à la base je ne travaillais pas exclusivement sur le mur, cette décision de cacher mon identité ne m’était pas venue.
Ton style de dessin est immédiatement reconnaissable. Par quelles étapes es-tu passé dans l’évolution de ton style ?
Le style est toujours une conséquence involontaire. C’est le résultat d’années de dessin, d’observations, de plaisir, et de votre propre sensibilité. En ce sens, mon travail est inspiré par de nombreuses références qui peuvent aller de la pop culture, au graphisme ou au cinéma soviétique.
La méthode adoptée a toujours été premièrement : la copie. « Voler » des ressources graphiques, visuelles ou esthétiques qui m’ont intéressé. Deuxièmement : « mélanger » toutes ces références, les adapter à ma propre sensibilité, à ma façon de penser. Et troisièmement : développer une façon de dessiner qui correspond à ma personnalité, c’est-à-dire utiliser un minimum d’énergie pour obtenir un maximum de résultats. Dessiner de manière simple, agréable.
À côté de ça, je reconnais qu’on peut se restreindre dans un seul style. Cette façon de limiter son travail à une seule approche rend paresseux. Et la paresse est l’un des grands ennemis de la créativité.
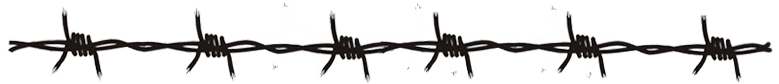

Quelles ont été tes influences ? Comment définirais-tu ton univers ?
Mes influences les plus lointaines dans le temps commencent probablement avec Picasso et le cubisme. En passant par la peinture murale de la Brigade Ramona Parra du Chili (El Mono González), ou Eduardo Muñoz Bachs (affichiste cubain). En passant bien sûr par toute la production d’affiches anarchistes et communistes (même socialistes) pendant la guerre civile espagnole.
Même chose pour les affiches soviétiques, celles de la Révolution Culturelle de Mao. Des artistes comme Keith Haring et des dessinateurs contemporains comme Clara Iris, Joan Manel, Roc Blackblock, Pablo Delcielo, etc…
Ma vision du monde est un univers traversé par la lutte des classes. Par le besoin de représenter les objectifs de la lutte sociale, ceux du marxisme-léninisme. Je me focalise sur l’objet politique que l’histoire oublie souvent : la classe ouvrière.

Pourquoi avoir choisi de privilégier la peinture acrylique et le pinceau ?
Par simple limitation. Je n’ai jamais étudié la peinture ou d’autres formes de travail à grande échelle, je me suis donc limité à cette technique que j’ai plus ou moins pu apprendre en autodidacte.
Même aujourd’hui, je ne suis pas très bon avec ça. Mais j’ai peur de m’essayer à d’autres techniques.
L’absence de dégradé de couleurs vient-elle d’un choix esthétique ou d’une contrainte technique (je pense à la sérigraphie) ?
Cela vient probablement de mes références visuelles, puisqu’il était déjà présent dans mon travail avant que je commence à travailler la sérigraphie.
Dans la couleur directe, je trouve un certain type d’application concrète des idées, c’est une façon de travailler qui fuit le maniérisme, ou la virtuosité.
Et dans son essence même se trouve le fondement solide de ce que je pense devoir être un objectif politique pour le champ des idées : avec le minimum, donnons le maximum.
Avec ce que nous avons à notre portée, avec le plus élémentaire, pour obtenir des résultats probants. Finalement, un art qui interpelle l’être humain dans sa condition de travailleur.
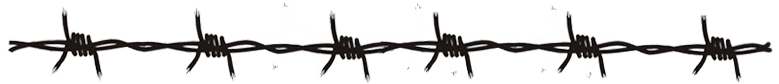

Comment as-tu découvert la culture DIY ?
C’est grâce à un groupe d’illustrateurs musiciens, de gens du théâtre à qui j’ai commencé à m’identifier au fil des années, et là je suis devenu membre de certains groupes, et nous avons mis en place des ateliers de sérigraphie en se concentrant sur la nécessité de générer notre propre base culturelle. De prendre les moyens de production intellectuelle pour générer un écosystème extérieur (mais non marginal) à un autre type de culture. Une culture en nette opposition avec les intérêts mercantilistes du marché de l’art, du capital et de l’idée qu’il faille « réussir » pour vivre de l’art.
Nous avons découvert ta peinture dans des lieux autogérés (au Rozbrat de Poznań, à l’Ex Caserma Rossani de Bari…). Que représentent ces endroits pour toi ? Comment s’établit le contact avec les occupant.e.s, et quelles sont les étapes qui te mènent à repeindre leurs façades ?

Visiter ces espaces a été pour moi une façon d’appréhender le monde d’une manière différente. Ce sont des espaces dans lesquels les relations de pouvoir du monde capitaliste n’existent pas. Dans lequel nous essayons, avec toutes nos erreurs, de construire un autre monde.
Et sinon, du moins des espaces libres de toute logique mercantiliste. Je dirais donc que les espaces autonomes sont les seuls où les relations humaines sont encore possibles.

Dans certains cas, lorsque vous peignez dans ces lieux, un espace différent est créé à la fois pour ceux qui l’habitent et pour les habitants du quartier. L’art peut parfois être une fenêtre. Il peut connecter différentes sensibilités et aider à composer un message intégrateur des différentes luttes politiques. De la dissidence de ces espaces on peut générer un monde meilleur, mais il est essentiel de communiquer la beauté qui y est générée : politique, culture, sport, participation citoyenne, écologie, féminisme…
Le militantisme manque souvent de capacité à communiquer la richesse qui se passe à l’intérieur des espaces libérés. Et là l’art, la fresque murale qui sort dans la rue, qui est peinte collectivement et qui implique finalement tout le quartier, la ville en somme, génère la communauté dont nous avons besoin pour rompre avec le virus du capital.

Comment s’est développée ta conscience politique ? Par le biais de ta pratique artistique, en parallèle, ou par d’autres moyens ?
Un militant Guatémaltèque m’a dit un jour : « d’abord la politique, ensuite l’art ». Bien que pour un artiste cela semble dur et moralisateur, ce n’est pas sans raison. Je pense que notre sentiment politique passe avant tout, votre conscience que vous avez acquise au fil des années. Une prise de conscience qui est traversée par votre condition sociale, votre sexe, votre origine, etc… vous pouvez passer de nombreuses années à prendre cette prise de conscience. Apprendre à utiliser l’art pour systématiser ces sensibilités prends du temps, mais c’est essentiel pour ceux qui sentent qu’avec l’art ils peuvent obtenir un outil pour lutter contre l’oppression. Dans mon cas, c’était la politique d’abord. Et puis vint l’art. Et bien des années plus tard, ce camarade guatémaltèque est venu me rappeler (à une époque où je l’avais peut-être oublié) que la politique passe toujours en premier.
Peut-on parler de « militantisme graphique » ? Penses-tu qu’il soit possible de passer un message en peignant ? Quel est ton avis sur le sujet ?
Absolument. Ma forme de militantisme en politique passe par le graphisme. Souvent je n’ai ni le temps ni l’énergie pour pouvoir participer à des projets, à des AG que je considère comme essentielles. Alors, je dis aux camarades de compter sur moi dans cet aspect. Ce que je peux offrir à la lutte. Que je suis une partie de plus du militantisme sur ces aspects. Ni mieux ni pire. Un de plus.
Je crois que de nombreux messages peuvent être diffusés à travers une fresque, et ils sont nécessaires et importants. Et pour cette raison, beaucoup de peintures murales ont été effacées par des groupes fascistes. S’il n’était pas possible de partager une contre-information, un message de résistance, pourquoi cela vous dérange-t-il autant ? Je crois que c’est nécessaire. C’est une obligation morale de l’artiste qui se sent révolutionnaire, qui croit à la destruction de ce système pourri.
Qu’il est prêt à se dépouiller de ses privilèges pour arriver à la fin de la lutte des classes. Le militantisme graphique est possible, en plus, je dis qu’il est nécessaire. Et il n’est pas assez pris en compte par les camarades.

Tu as également fondé la compagnie théâtrale « Atirohecho », peux-tu nous en parler ?
Atirohecho est un projet de théâtre politique que j’ai monté avec ma compagne Carla Chillida. Elle en est la directrice et le moteur révolutionnaire de ce groupe, l’artiste prolétaire par excellence. Elle a été pour moi, dès mon plus jeune âge, une école d’apprentissage politique et artistique. Atirohecho est un espace où toutes les révolutions qui ont besoin de chansons trouvent leur place. En lisant, en écoutant ou en dansant un slogan. Tandis que les textes sont écrits patiemment et laborieusement. C’est précisément au moment où le militantisme, l’art et la politique s’entremêlent que se produit Atirohecho.
Que penses-tu des commandes institutionnelles à l’initiative des mairies, qui « engagent » des artistes étiquetés « street-art » pour repeindre des façades ? Ne penses-tu pas que ces tentatives de récupération peuvent nuire au message initialement contestataire de certaines fresques ?
Il y a très peu de cas où des artistes politiques occupent ces espaces. Parfois, dans de petits événements, dans des lieux où l’on ne nous attend pas. Mais la logique mercantile de ce type de contrats me donne l’intuition qu’ils servent à d’autres fins que les intérêts de générer un cadre de conscience collective sur les problèmes du capitalisme.
Ils sont plutôt une vitrine désireuse de tourisme pour des passants qui se sentent à l’aise, qui trouvent agréable ce type d’art monumental, qui n’entre pas en conflit avec les problèmes sociaux. Ce sont des espaces pour un art qui n’altère pas la « paix sociale ».
Ils n’interrompent pas le sommeil chaleureux de la bourgeoisie. Je crois que ce ne sont pas des espaces où il y a une bataille d’idées. C’est du plaisir visuel, sans place pour les voix dissidentes. Il peut y avoir une critique sociale, bien sûr, mais toujours à partir d’un consensus majoritaire. Pas à partir de positions radicales. Ces projets s’inscrivent dans l’organisation bourgeoise du territoire, une manière de prendre en compte l’art comme simple objet décoratif.
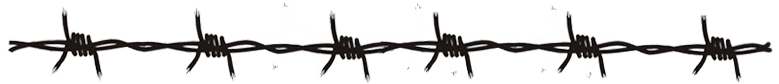

Quels sont tes projets futurs ?
Un roman graphique sur le MPAIC, le mouvement indépendantiste des îles Canaries dans les années 70. A travers la figure d’Antonio Cubillo, militant révolutionnaire et anticolonialiste. On se souvient de lui pour les luttes panafricanistes pour la libération des chaînes économiques et politiques qui nous étaient imposées dans les territoires subeuropéens. Un projet qui va me prendre beaucoup de temps encore…
Quels sont les lieux que tu rêverais de peindre un jour ?
Partout où la peinture peut générer un sentiment de communauté, remonter le moral, réchauffer les cœurs, motiver l’esprit combatif de la classe ouvrière dans ses luttes inlassables : contre le génocide capitaliste, sioniste, machiste. Contre l’oppression, du côté des damnés de la terre.
Quels sont les 3 albums de musique qui pourraient le mieux représenter ton univers graphique ?
“Al final de este viaje” de Silvio Rodríguez
“Rural” de Tesa
“Las desheredadas” de Tribade